le mal n'est pas en nous, François Rivenc
le mal n'est pas en nous
François Rivenc, 1997
J'ai récemment appris par la presse (Libération, Le Monde) qu'André Glucksmann avait tiré de ses réflexions sur le Bien et le Mal, titre de son dernier ouvrage, la conclusion suivante : le mal est en chacun de nous, sous la forme d'un nazi supérieur que nous devons combattre. Comme je me battais en vain les flancs pour palper mon uniforme de SS, j'ai lu plus attentivement la formule de contrition qu'on me proposait d'ânonner. J'ai compris alors qu'il n'y était pas exactement question de camp ni de solution finale planifiée, mais du «crime d'indifférence» dont nous autres Européens, nous nous rendions collectivement coupables à l'égard des massacres et autres égorgements commis un peu partout sur la planète.
Roger-Pol Droit, rapportant la pensée de Glucksmann dans Le Monde des Livres, parle ainsi de notre «magnifique système d'indifférence», d'une «insensibilité sans précédent envers la misère du monde».
À la réflexion, ce «sans précédent» m'a fait tiquer, et me laisse incrédule. Jadis, naguère, la pitié pour la souffrance du prochain fut-elle donc un phénomène de masse ? Quel cataclysme spirituel a provoqué dans la conscience des masses romaines le massacre des Innocents, ou dans la conscience des masses européennes le sort que Temudjin (autoproclamé Gengis Khân) réserva aux habitants de Merv, dont le Petit Robert signale que «ses habitants furent systématiquement décapités, et des pyramides de têtes élevées devant la cité ?»
Pour quelques voix comme Bartolomé de Las Casas (Relación de la Destrucción de las Indias) ou Michel Eyquem de Montaigne, quelle masse d'approbation, de silence, ou tout simplement d'ignorance contemporaine de l'extermination des Indiens d'Amérique ? Naturellement, je prends ces atrocités extra-européennes au hasard, et pour ce qu'elles sont : la basse continue sur fond de laquelle les hommes ont continué de vivre, avec leur peine quotidienne qui leur suffisait bien, sans doute, à nourrir leur souci.
Du coup, je doute fortement que notre indifférence soit pire qu'autrefois (je veux dire : quantitativement ; quant à la question de savoir si elle est plus ou moins criminelle, il me paraît extrêmement compliqué d'y répondre de manière fondée).
Une autre hypothèse, suggérée par Nietzsche et non moins plausible, est que notre seuil de tolérance à la souffrance, y compris celle d'autrui, s'est considérablement abaissé avec le développement de la civilisation moderne ; sans doute est-il encore plus faible chez ceux qui nous imputent comme crime le mélange de résignation et d'impuissance qui est le lot des individus ordinaires (sans compter, pour certains d'entre nous, le doute sur les moyens les plus efficaces et les moins dangereux de changer les choses, que l'expérience du socialisme réel justifie largement).
Peu importe : prétendre comparer des quantités d'indifférence d'une époque historique à une autre est sans doute le type même des pseudo-questions, des questions sans signification ni réponse, qu'affectionne la production «philosophique» des mass médias.
Je reviens à mon nazi intime, à votre nazi intérieur, à tous ces nazis qu'on nous demande de traquer au fond de nous. Et je dois dire que je ne crois pas un seul instant à leur existence.
Je dois dire que cette affliction de moraliste, qui prétend nous faire gémir sur notre indignité, commence à sérieusement m'exaspérer. Je prétends de surcroît que cet air de morale n'a rien à voir avec l'effet d'attrister, qu'induit inévitablement l'effort pour analyser le phénomène nazi, tel que Primo Levi, par exemple, de manière à mon sens inégalée, l'a soutenu dans les Naufragés et les rescapés (je pense en particulier à l'analyse fine qu'il propose des degrés de participation et de compromission à l'univers du Lager, dans le chapitre intitulé «La zone grise»). Oui bien sûr, on ne peut que trouver dans le nazisme une formidable objection à l'humanité, ce troupeau d'animaux malades ; c'est un devoir d'intelligence (et de précaution pour l'avenir) d'aller plus loin, et de démêler l'écheveau des fils qui le rendirent possible.
À la réflexion, il est facile de comprendre pourquoi tout à l'heure je ne parvenais pas à trouver le nazi en moi ! C'est que ce nazi est hors de moi, comme le vôtre est à l'extérieur de vous, comme pour chacun de nous à quelques exceptions près (mais pour ceux-là, point n'est besoin de chercher le nazi au fond d'eux-mêmes ; ce sont des nazis !).
Un peu de conscience historique, toujours plus féconde que la conscience morale, nous ferait comprendre en quel sens ce nazi possible, c'est-à-dire la possibilité de devenir nazi, ou nazi-indifférent, ou non-nazi mais qui ne veut pas voir le nazisme, etc., est extérieur à nous. Il n'est pas besoin d'être spécialement marxiste pour croire qu'une large partie de l'intériorité de l'homme lui est extérieure, faite de rapports historiques et sociaux. Ce fut même, il y a quelques années encore, affaire de connaissance commune, et de ce point de vue les pensées de Glucksmann sur le Bien et le Mal me paraissent la marque d'une régression intellectuelle.
Or il y a mieux à faire que de nous inviter à contrition ; nous savons en gros certaines choses sur les conditions sociales et historiques de la prise du pouvoir par le nazisme, prise du pouvoir dans les esprits et prise du pouvoir politique. Je n'ai pas la prétention de faire un scoop en rappelant que sans la destruction volontaire, par les Alliés de 1918, de l'Empire austro-hongrois, le nazisme n'aurait pas été possible, question de géopolitique (c'est l'avis de bons historiens) ; pas plus qu'en rappelant que le spectre du communisme hantant l'Europe a dû être pour quelque chose dans les complaisances dont les diverses forces traditionnelles ont fait preuve à l'égard d'un phénomène qui par ailleurs répugnait à leurs meilleurs représentants, etc.
Le chantier de la compréhension historique du nazisme n'est cependant, pas que je sache, achevé. Et de plus, il y a beaucoup de travail à faire pour diffuser et vulgariser cette connaissance, dont on ne peut guère dire qu'elle soit largement partagée dans le public et la conscience commune. Tout ce travail, qu'il fasse appel à l'histoire sociale, à la psychologie des masses, à la géopolitique ou à la psychanalyse, peut donner du grain à moudre à la philosophie populaire (au meilleur sens, cette fois, du terme). Il remplacerait avantageusement les discours d'autoflagellation.
Si Glucksmann ne soutient pas réellement le point de vue que la presse lui attribue, qu'il me pardonne, et surtout, qu'il rectifie l'image qu'on distribue de sa pensée. Mais ce qui m'importe, c'est l'avachissement de la pensée publique (celle qu'on lit dans les journaux et qui fait tache) et sa rechute dans la morale. Le moralisme est une capitulation de l'intellect, et la résistance au nazisme commence sans doute par le désir d'y voir clair.
François Rivenc est philosophe, Paris-I Sorbonne
Libération, 22 septembre 1997,
article paru sous le titre :
"Non à l'avachissement de la pensée publique :
le moralisme est une capitulation de l'intellect"

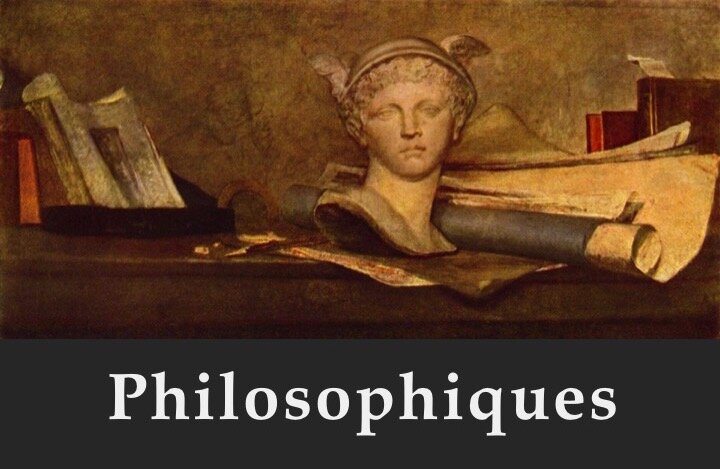

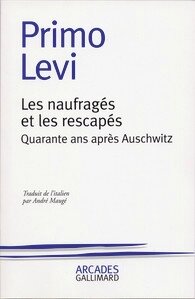
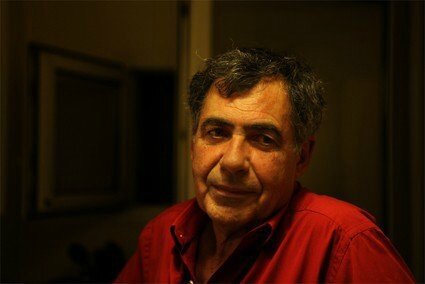

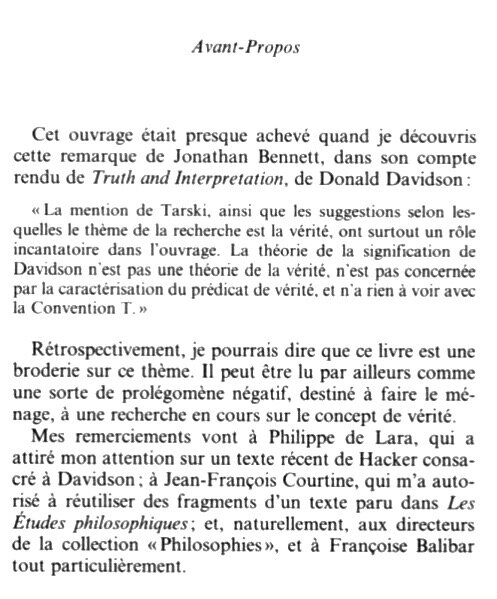



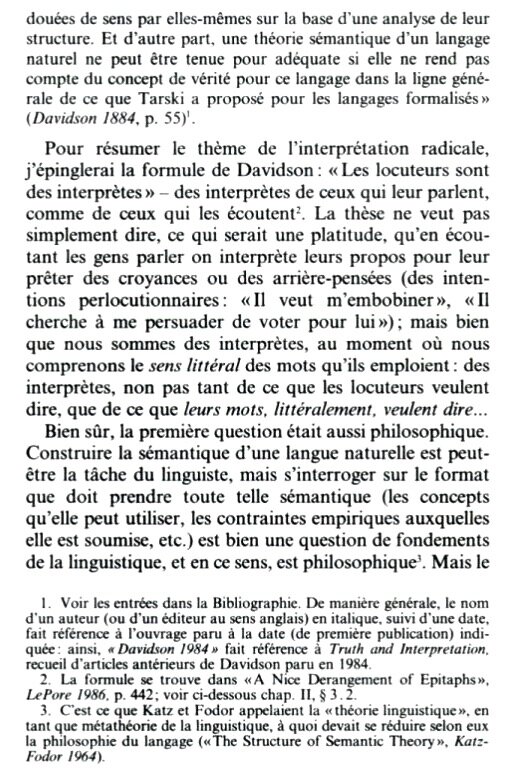




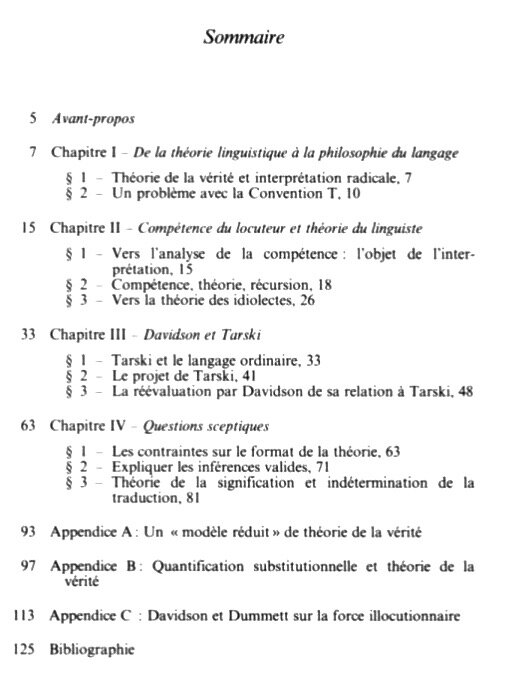




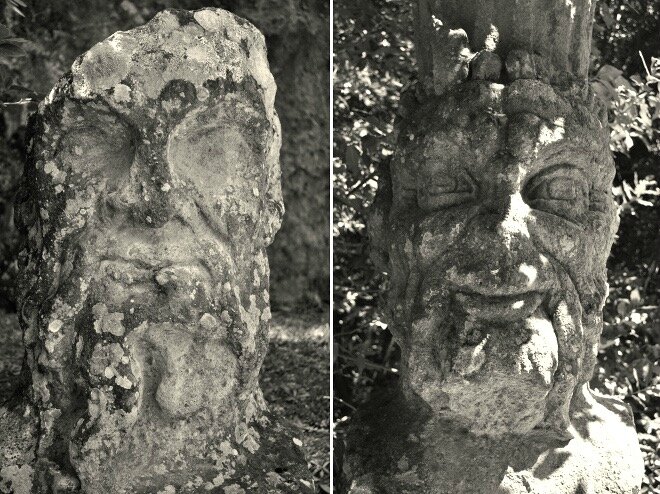
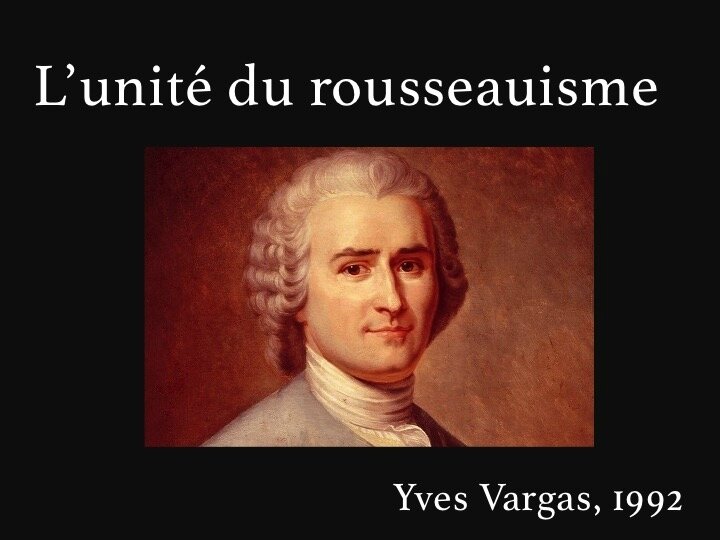



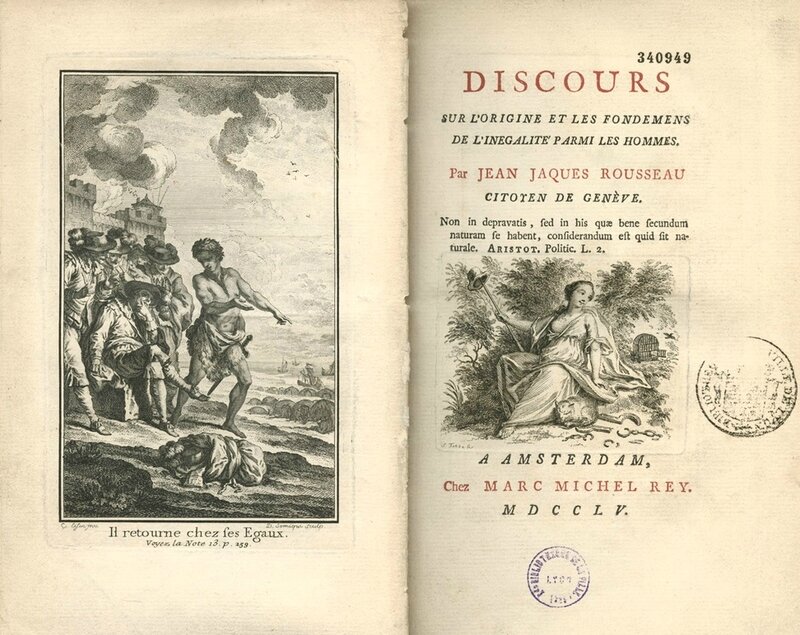






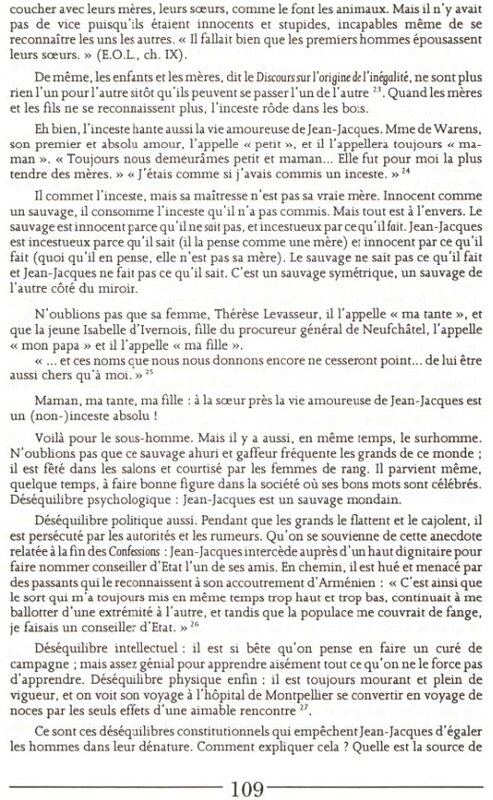
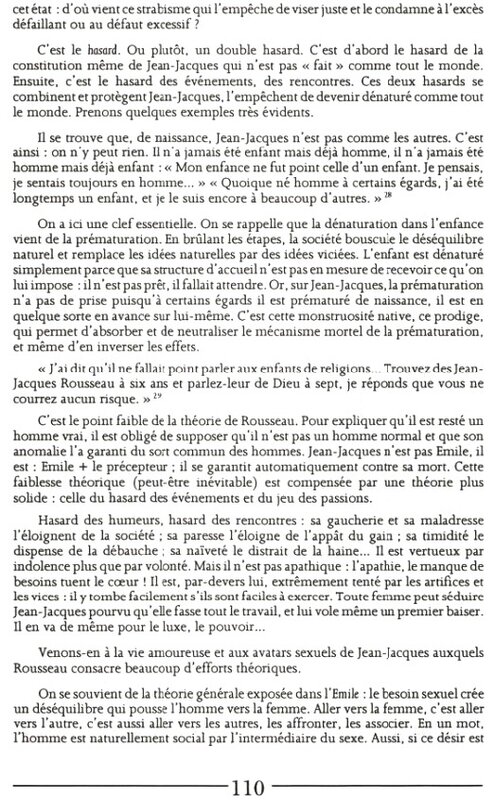










/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F3%2F93349.jpg)